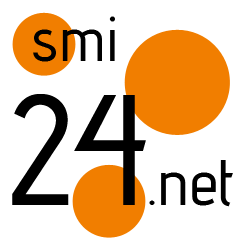Alstom est-il enfin sur de bons rails ? Les vérités d'Henri Poupart-Lafarge
Terminus en vue pour Henri Poupart-Lafarge. PDG d’Alstom depuis 2016, le polytechnicien avait perdu sa casquette de président l’an dernier, après une déconfiture boursière dont le groupe, éjecté du CAC40, se relève à peine aujourd’hui. En avril prochain, il tirera définitivement sa révérence et cédera son fauteuil de directeur général à Martin Sion, l’actuel patron d’ArianeGroup.
Entré chez le constructeur de trains il y a près de trente ans, cet amoureux du rail a fait d’Alstom le deuxième acteur mondial, derrière la compagnie d’Etat chinoise. "Le premier en réalité, corrige son entourage, car CRRC est essentiellement tournée vers son immense marché domestique." Sous son règne, le chiffre d’affaires a quasiment triplé - 18,5 milliards d’euros au dernier exercice. Mais sa plus grande fierté vient d’un autre indicateur, le net promoter score, qui mesure la satisfaction client : "Il est à son plus haut niveau historique. Plus élevé encore qu’avant l’acquisition de Bombardier Transport".
Un sacré morceau que ce rival canadien, avalé en 2020 pour près de 6 milliards d’euros, et dont la digestion s’est révélée plus longue et chaotique que prévue. A l’heure du bilan, Henri Poupart-Lafarge se félicite de l’année record qui s’annonce. La marge du premier semestre, dévoilée le 13 novembre, s’établit à 6,4 %, contre 5,9 % un an plus tôt. Et les ventes de toutes les divisions sont en hausse. Un retour à meilleure fortune… qui fera le bonheur de son successeur.
Le bout du tunnel boursier
Les actionnaires d’Alstom n’ont pas oublié leur jeudi noir, ce 5 octobre 2023, où le cours de Bourse s’est effondré de presque 40 %. En cause : des difficultés de trésorerie qui ont surpris les marchés et conduit le groupe à cumuler 3 milliards d’euros de dette. Le tunnel de la défiance fut long à traverser pour Henri Poupart-Lafarge. Si, à quelques mois de la fin de son mandat, le DG en voit le bout, regagner les faveurs des investisseurs n’est pas chose aisée. Surtout quand la trésorerie continue de faire des yo-yo, dans un sens comme dans l’autre. En juillet dernier, le groupe envisageait une consommation de cash d’un milliard d’euros au premier semestre 2025-2026, elle se limite finalement à 740 millions. "Cette volatilité est inhérente à notre type d’entreprise, explique le patron. Nous pouvons recevoir des paiements de plusieurs centaines de millions d’euros en une seule fois. Par exemple, quand le design d’un train est achevé, nous touchons parfois 10 % du contrat." Sans compter une saisonnalité propre à cette industrie, avec des mois d’été au ralenti et une fin d’année en fanfare.
En dépit de ces soubresauts comptables, les affaires tournent aujourd’hui à plein régime. Les nouvelles commandes sont plus rentables que les anciennes. Le rachat de Bombardier, à l’origine du déraillement boursier d’Alstom, est désormais soldé, assure le dirigeant. Majeure, l’opération lui a apporté deux marchés clés - l’Allemagne et les Etats-Unis – mais aussi beaucoup d’ennuis. Le pompier Poupart-Lafarge a dû traiter en urgence les mécontents – "en Suisse ou en Californie, certains projets ne répondaient pas du tout aux exigences des clients". Uniformiser les systèmes informatiques entre les deux entreprises - sur l’ingénierie, il reste encore du travail. Et rationaliser le catalogue de pièces et de composants.
Signe que le mariage est consommé : dans le nouveau plan de route interne, tout juste adopté, le nom de l’industriel canadien n’apparaît plus nulle part. L’augmentation de capital d’un milliard d’euros l’an dernier et plusieurs cessions d’actifs ont redonné de l’air au groupe. En l’espace de douze mois, l’endettement net a été ramené à 430 millions. Et l’action, aujourd’hui, a retrouvé son étiage d’il y a deux ans, autour de 24 euros. Problème : elle en valait le double en 2020, avant qu’Alstom ne fasse monter Bombardier à bord.
Des contrats à la chaîne
Quarante-deux rames à deux niveaux, 30 ans de maintenance et 1,6 milliard d’euros à la clé. Le contrat annoncé en Pologne par Alstom le 12 novembre est le dernier en date d’une belle série : 30 TGV pour Eurostar plus 20 en option, 39 trains destinés au métro de Mumbai, 200 voitures dans le New Jersey… Dans le monde entier, le groupe multiplie les succès. Aux Etats-Unis en particulier, il tire profit d’un marché d’autant plus porteur que les Américains délaissent le télétravail et reprennent le chemin du bureau. La fréquentation des lignes d’Amtrak, la SNCF américaine, est en plein boom.
La clé pour décrocher des clients ? Jouer "multilocal". Le français Alstom est australien en Australie, sud-africain en Afrique du Sud, canadien au Canada. Fabriquer sur place pour le marché domestique flatte le patriotisme ferroviaire de chacun. "L’évolution du monde valide cette approche, observe Henri Poupart-Lafarge. On voit chaque jour des pays favoriser la production locale par de nouvelles réglementations. Chez Alstom, nous avons peut-être perçu ce mouvement avant les autres, car le ferroviaire a toujours été une industrie emblématique, avec des champions nationaux financés par de l’argent public. C’est un domaine où le 'localisme' règne." Dernièrement, les chemins de fer fédéraux suisses ont provoqué un tollé en signant avec l’allemand Siemens, et non Stadler, le constructeur helvétique. Alors, quand le Premier ministre indien Narendra Modi se fend d’un tweet pour se réjouir d’un contrat remporté par la filiale nationale d’Alstom, c’est toute la stratégie d’internationalisation menée par le groupe, présent dans 63 pays, qui se trouve couronnée.
Les retards de livraison, une spécificité française
La SNCF aurait dû recevoir ses nouvelles rames de TGV M début 2024. Les premières d’entre elles - une douzaine, sur les 115 commandées - n’arriveront qu’au printemps prochain. Quant aux 146 trains censés opérer sur la ligne du RER B, ils ne devraient rouler qu’en 2029, avec quatre ans de retard. A l’évocation de ce mot, qui colle à l’actualité d’Alstom comme le sparadrap du capitaine Haddock, Henri Poupart-Lafarge rappelle le contexte. "Le cas français est très particulier. A quoi tient cette exception ? Trois événements majeurs ont coïncidé en France ces dernières années. La volonté de la région Ile-de-France de renouveler entièrement la flotte de matériels roulants. La construction du Grand Paris express. Et la décision de la SNCF de se doter d’un nouveau TGV, ce qui arrive une fois tous les 30 ans.
Alstom a dû concevoir en même temps huit nouveaux matériels : un tramway, quatre métros, deux RER et un TGV. C’est du jamais vu. Tous ont été livrés à l’heure, ou sont en passe de l’être, sauf le RER B et le TGV M, qui subissent des retards effectivement. Ces derniers ne sont pas liés à la production des trains mais à la phase de développement, qui inclut les allers-retours avec le client et différentes étapes de tests ou de certifications. Nous avons encore des progrès à faire en matière d’ingénierie, j’en conviens. Mais la complexification des normes, qu’elles soient françaises ou européennes, ne nous facilite pas la tâche." Pour être homologué, le RER B doit être soumis à un crash-test avec un camion sur un passage à niveau. Tant pis si la ligne n’en compte aucun… Quant au TGV M, il a déjà donné lieu à des milliers de réunions. "La SNCF ne veut pas un train standard, elle veut le sien, avec ses équipements, ses technologies, ses services à bord. Le TGV M est d’ailleurs issu d’un partenariat d’innovation avec l’ingénierie de la SNCF. C’est tout à fait compréhensible, ce nouveau TGV va être son fer de lance pendant plus de 50 ans ! Ce codéveloppement est forcément plus long que le choix d’une solution sur étagère, explique le patron d’Alstom. Mais nous travaillons de manière très étroite et très collaborative avec la SNCF pour minimiser ce temps." Vivement l’arrivée en gare.