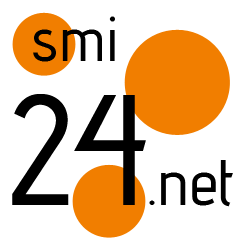Vouloir produire sans construire, une incohérence française, par Cécile Maisonneuve
Chauves-souris, grand hamster d’Alsace, sonneur à ventre jaune, triton crêté, outarde canepetière, grand tétras, cistude d’Europe, tarier pâtre, lézard des murailles... Qu’ont en commun ces petites bêtes ? Au cours des dix dernières années, elles ont été invoquées dans des recours environnementaux pour bloquer ou retarder des chantiers d’infrastructures et de bâtiments industriels en France. Le data center de DATA4 à Marcoussis, les usines Rockwool à Courmelles ou Bridor à Liffré, des serres agricoles en Vendée, des réserves d’eau à Sainte-Soline ou encore l'autoroute A69.
Ces créatures, souvent protégées, ne sont pas la cause des blocages. Elles sont le symptôme d’un problème plus profond : la dévalorisation, la mise en accusation systématique de l’acte de construire lui-même. Car construire, c’est transformer le paysage, consommer des ressources, avoir un impact sur des habitats. Or, dans notre pays, cet acte est devenu suspect, synonyme de prédation sur la nature. Bâtir un poulailler, une serre, une usine, un entrepôt, un data center, un logement, une route ou une centrale est devenu un geste qu’il faut justifier, excuser, compenser. Et auquel il faut parfois renoncer.
Ce basculement n’est pas le fruit d’un complot, mais d’une accumulation. D’abord, un empilement normatif croissant : études d’impact, inventaires saisonniers, dérogations "espèces protégées", autorisations environnementales, enquêtes publiques, contentieux multiples. Ensuite, une bureaucratie proliférante, où faire la loi est plus simple que piloter les administrations chargées de l’appliquer. Puis un système judiciaire qui, par la longueur des procédures et l’asymétrie des risques, laisse un avantage structurel aux plaideurs face aux faiseurs. À cela s’ajoute un manque de courage politique local, où l’on préfère satisfaire l’association la plus bruyante plutôt que porter un projet productif, pourtant légalement autorisé.
A la racine de cet état de fait, un malthusianisme rampant, qui postule que la croissance humaine dépasse inévitablement les capacités finies de la Terre. La notion d’empreinte environnementale en est l’héritière directe. Formalisée dans les années 1990 par William Rees et Mathis Wackernagel, elle quantifie la pression humaine sur la biosphère, en la ramenant à une surface mobilisée. Inspirée de la pensée des limites vulgarisée par le Club de Rome aux débuts des années 1970, elle rompt avec l’idée d’une croissance infinie, imposant une vision normative : dépasser les limites naturelles est une faute. Ce cadre philosophique, anti-prométhéen, se méfie de la technique et prône la contrainte sur les flux matériels. Le dispositif s’est cristallisé en France en 2005, avec l’inscription du principe de précaution dans la Constitution via la Charte de l’environnement.
Résultat : des délais interminables pour autoriser des projets. Dans notre pays, une autorisation environnementale pour une implantation industrielle prend en moyenne 17 mois, contre 3 à 7 mois en Allemagne ou 9 à 10 mois en Espagne. Sauf qu’avec le changement de paradigme post-2020, tout cet édifice entre en collision frontale avec la nécessité de reprendre la main sur nos chaînes de valeur. Pandémie, tensions géopolitiques, climat : on clame la nécessité de relocaliser la production, de produire au plus près afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Les usines, les data centers, les infrastructures énergétiques ? Chez nous ! Mais comment produire sans construire ? Le paradoxe culmine avec l’opposition au Mercosur : on refuse d’importer, tout en bloquant ici les outils pour produire.
Ceux qui disent qu’il faut tout changer pour affronter les enjeux climatiques ne veulent en fait rien changer : ils figent l’existant qu’ils taxent pourtant d’insoutenable. Vous avez dit incohérence ? Revenir au réel est nécessaire… mais pas facile. Nous touchons, bien au-delà, des cercles écologiques, à un profond mal français, si bien décrit par Raymond Aron dans son Introduction à la philosophie politique : "Dans l’ensemble, on peut dire que les Français, en politique, ne sont ni philosophes ni empiriques. Ils n’ont ni le goût de penser systématiquement leur politique, ni le goût de voir les choses comme elles sont : ils sont proprement idéologues. Ils essaient de saisir la réalité politique à travers un système de préférences morales ou métaphysiques assez vagues." La question est pourtant précise : "To build or not to build."