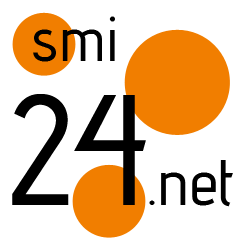Pluribus : pourquoi cette série est une ode au libéralisme
À première vue, la nouvelle création d’Apple TV, Pluribus, coche toutes les cases de la série apocalyptique. Le "pitch" est simple : des scientifiques américains interceptent un signal radio émis depuis plus de 600 000 années-lumière de la Terre qui, une fois décrypté, se révèle être la recette d’une séquence génétique. Reproduite en laboratoire, celle-ci échappe au contrôle des scientifiques et se transforme en un virus extraterrestre, programmé pour infecter l’humanité tout entière.
Mais à rebours des classiques du genre, comme The Walking Dead ou The Last of Us, la nouvelle série de Vince Gilligan – créateur des mythiques Breaking Bad et Better Call Saul -, ne donne à voir aucun paysage de désolation. Pas d’autoroutes jonchées de carcasses de voitures, ni d’immenses villes désertes où la nature reprend progressivement ses droits. Dans Pluribus, l’apocalypse prend la forme d’un monde ordonné, paisible et pacifique. Le virus ne transforme pas les humains contaminés en créatures monstrueuses, il les fond dans une humanité commune, où l’esprit de chaque individu s’efface au profit d’une conscience collective. Seuls les corps demeurent intacts. Une sorte de ruche planétaire, où près de sept milliards d’êtres humains partagent une seule et même psyché et communient dans la paix, la bienveillance, et la connaissance - puisque cet esprit est dépositaire de l’ensemble des savoirs, compétences et expériences accumulées depuis l’aube de l’humanité. Dans Pluribus, aucun zombie vociférant à la démarche traînante et aux vêtements en lambeaux ne menace les survivants. Bien au contraire. Les individus contaminés ne pourraient être plus serviables et bienveillants. Certes, l’esprit collectif cherche à résoudre scientifiquement le mystère de l’immunité des derniers récalcitrants ; mais en attendant, ils se comportent avec eux avec la plus grande déférence.
Car pour faire une bonne série, il faut un grain de sable : treize individus, disséminés aux quatre coins du globe, semblent totalement immunisés au virus. Parmi les survivants, Carol Sturka - interprétée par Rhea Seehorn -, romancière à succès, cynique et misanthrope, n’a absolument aucune envie de sacrifier son individualité pour goûter au paradis terrestre que lui promet l’esprit collectif. Retranchée dans sa maison cossue installée sur les hauteurs de la ville d’Albuquerque (au Nouveau-Mexique), elle envisage ni plus ni moins que... de sauver le monde.
Une critique acerbe du collectivisme ?
Mais la série de Vince Gilligan ne se résume pas à ce scénario audacieux. Elle invite à une véritable réflexion de philosophie politique en jouant constamment sur une tension entre collectivisme et individualisme. Le virus donne ici corps au vieux rêve des ingénieurs sociaux : une société tirée à quatre épingles, intégralement rationalisée, où les conflits, produits de la confrontation des intérêts privés, sont éliminés comme autant de dysfonctionnements nuisibles à l’harmonie collective. L’un des pères du socialisme moderne, Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825), aurait sans doute sorti le popcorn. Le philosophe et économiste était en effet convaincu que les principes de la rationalité scientifique et industrielle pouvaient être transposés à l’organisation sociale, seul moyen d’apporter prospérité et paix durable. La société devrait, imaginait-il, être dirigée par des "experts" : ingénieurs, scientifiques, industriels, organisateurs. Après sa mort, ses disciples – les saint-simoniens – pousseront cette logique jusqu’à parler d’une "religion de l’humanité". Le personnage de Zosia apparaît comme le reflet contemporain de cette tentation messianique. Cette contaminée, qui joue le rôle de médiatrice zélée entre Carol et l’esprit collectif, tente désespérément de convaincre notre héroïne, par la force des arguments, que son salut passera par la fusion.
Les neuf épisodes foisonnent de références, explicites ou allusives, aux régimes totalitaires du XXe siècle. On pense, par exemple, à ces contaminés qui centralisent et collectivisent les ressources récupérées dans les commerces et les anciens foyers individuels pour rationaliser la distribution de nourriture et de médicaments. Ou encore à cette scène où Carol découvre que la "fusion" de l’humanité a coûté la vie à 886 477 591 personnes. "J’imagine qu’on doit casser quelques œufs", ironise alors la romancière, un clin d’œil à peine voilé aux compagnons de route occidentaux du communisme, prompts à fermer les yeux sur les exactions de l’Union soviétique. Enfin, là où les régimes totalitaires justifiaient le recours à la violence et à la répression - ici pour faire advenir la société sans classes, là pour purifier la société nationale de ses corps étrangers - l’esprit collectif de Pluribus invoque un "impératif biologique".
Confrontée à ce système qui considère le sacrifice de quelques millions de vies comme un mal nécessaire au salut de l’humanité, Carol campe le rôle de résistante. Elle ne manque jamais une occasion de souligner la contradiction d’un projet qui se prétend pacifiste, mais refuse aux individus la liberté d’y consentir – ou non. "À ma connaissance, vous n’avez rien demandé à personne. Que je sache, les gens n’ont pas voté pour dire s’ils voulaient fusionner", rétorque-t-elle à Zosia, lorsque celle-ci lui affirme que "notre fusion est l’antithèse de l’esclavage".
Une série profondément libérale ?
Mais l’originalité – et le culot – de cette série tient à sa défense assumée de l’individualisme libéral. Les arguments mobilisés par Carol en témoignent à chaque instant. Au fond, dit-elle autre chose que le philosophe Benjamin Constant, lorsqu'il affirmait au XIXe siècle qu’"il y a une partie de l’existence humaine qui reste individuelle et indépendante, et qui est hors de toute compétence sociale" ? Surtout que la liberté défendue par l’héroïne ressemble à s’y méprendre à la "liberté des Modernes", exposée dans le célèbre discours de Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (1819), et qu’il définit comme "le droit de n’être soumis qu’aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d’aucune manière, par l’effet de la volonté arbitraire d’un ou de plusieurs individus : c’est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de l’exercer, de disposer de sa propriété, d’en abuser même". À l’inverse, la "liberté des Anciens", qui met l’accent sur la participation politique, admet "comme compatible avec cette liberté collective l’assujettissement complet de l’individu à l’autorité de l’ensemble" ; "rien n’est accordé à l’indépendance individuelle", car "l’autorité du corps social s’interpose et gêne la volonté des individus". Là où Zosia n’y voit aucun inconvénient, Carol, en revanche, ne supporte pas l’idée que l’on veuille faire son bonheur à sa place. Elle pourrait sans peine reprendre à son compte la conclusion de Constant : "Prions l’autorité de rester dans ses limites ; qu’elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d’être heureux".
Un parti pris d’autant plus courageux que l’individualisme n’est guère en odeur de sainteté ces dernières années. Dans son anthologie L’autre individualisme (Les Belles Lettres, 2016), Alain Laurent évoque même un "anti-individualisme triomphant" pour qualifier ce désamour. Selon le philosophe, gauche et droite communient désormais dans la dénonciation d’une modernité parasitée par "l’individu roi". L’individualisme, écrit-il, se trouve ainsi "exclusivement essentialisé en pure expression des fléaux moraux et sociaux les plus infamants : chacun pour soi égoïste, repli sur soi asocial, narcissisme irresponsable". Mais il y a d’un côté le "bon" individualisme - ce qu’Alain Laurent nomme "l’individualisme bien compris" - et de l’autre sa caricature, incarnée dans Pluribus par l’un des treize survivants, Koumba Diabaté. Loin d’être alarmé par la disparition de l’humanité, ce Mauritanien fantasque et affable est bien décidé à tirer le meilleur parti de la situation. Lorsqu’il ne voyage pas à bord d’Air Force One, il séjourne dans des palaces, entouré de top models en petite tenue et d’une armée de serviteurs qui lui obéissent au doigt et à l’œil. Après tout, si l’esprit collectif et ses sbires répondent à ses moindres désirs, pourquoi se priver d’une vie de seigneur ? Cet égoïsme et cette absence totale de sens du collectif sont aux antipodes de "l’individualisme bien compris". Celui-ci se définit comme "le refus exprimé par un individu de se laisser faire en laissant d’autres – isolément, en bandes organisées ou via des institutions – décider à sa place de ce qui doit lui convenir et de ce qu’il doit faire de lui-même". La philosophie de Koumba Diabaté est tout autre : sa liberté repose sur l’asservissement et l’exploitation des individus contaminés par l’esprit collectif. Au contraire, Carol incarne bien davantage cet individualisme libéral indissociable de la notion de responsabilité individuelle : "Je ne vais pas vous appeler à chaque fois que j’ai besoin de quelque chose, je ne veux pas que vous me serviez, je suis une personne très indépendante", insiste-t-elle auprès de Zosia quand celle-ci lui propose de lui faire livrer sa nourriture.
Dans De la démocratie en Amérique (1840), le libéral Alexis de Tocqueville identifiait déjà le lien entre despotisme, infantilisation et repli sur soi égoïste. "Je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petit et vulgaire plaisir […]. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres […]. Au-dessus de ceux-là, s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leurs jouissances, et de veiller sur le sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux." Un siècle et demi plus tard, Pluribus donne chair à cette intuition tocquevilienne d’un despotisme doux, et Koumba Diabaté incarne à la lettre la figure de l’individu replié sur sa jouissance privée, mais dépendant d’un pouvoir tutélaire.
Dans un paysage artistique saturé de séries et de films recyclant les mêmes messages politiques convenus et consensuels – ici la dénonciation du péril écologique, là des inégalités sociales -, Pluribus détonne. En assumant un propos résolument libéral, Vince Gilligan signe l’une des rares fictions contemporaines qui ose aller à contre-courant de "l’anti-individualisme triomphant". Pari risqué, mais pari réussi.